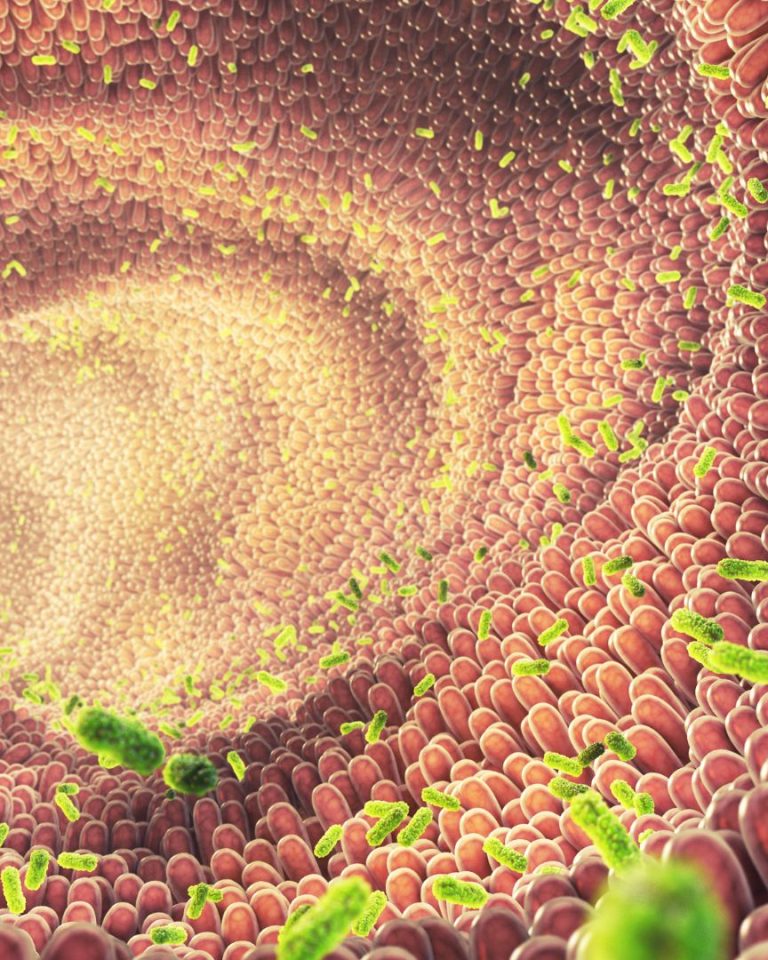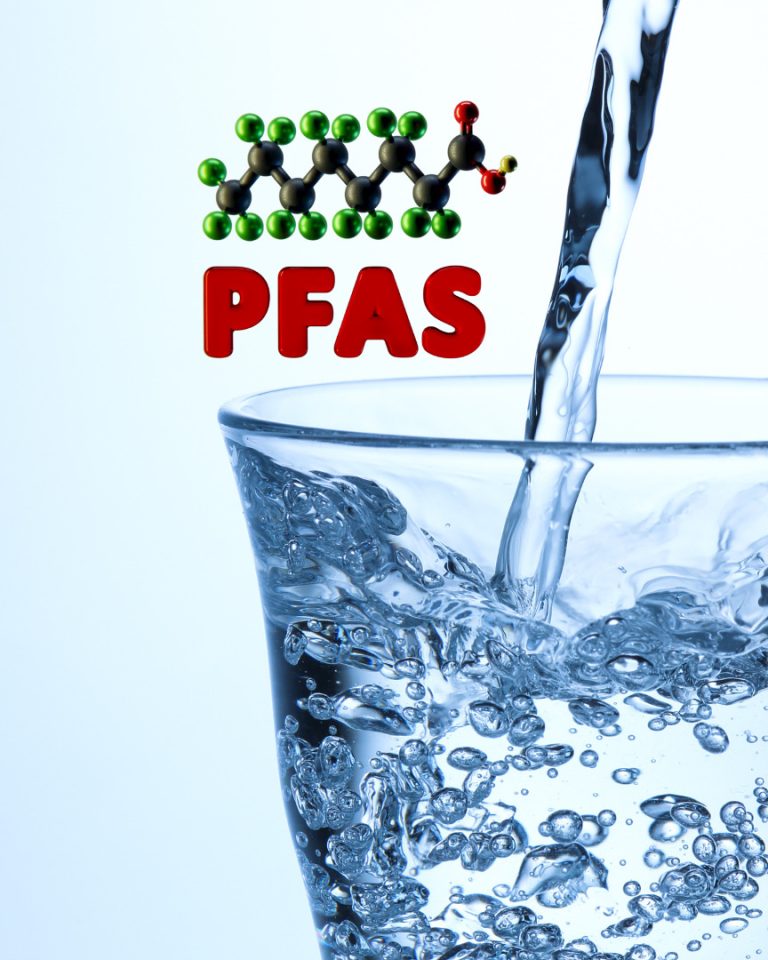Les débats autour la compensation carbone divisent États et associations de défense de la nature. Ces dernières dénoncent un recul face à la lutte climatique ainsi qu’une marchandisation de la nature.

À la COP26, l’article 6 de l’Accord de Paris perturbe les débats. Afin de lutter contre les dérèglements climatiques, le texte permet à chaque pays de compenser ses propres émissions carbone en finançant le projet écologique d’une entreprise ou d’un autre pays. Il s’agit alors de favoriser ce que l’on appelle les « solutions fondées sur la nature » (Sfn). L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit ce terme comme « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés(…) tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité”.
Ces actions visent par exemple à replanter des arbres, restaurer des tourbières, ou encore créer et entretenir des espaces verts dans le cœur urbain afin de contribuer à la lutte climatique . Ces services achetés se mesurent en crédits carbone. Un marché désormais en croissance, compte tenu de la pression climatique et sociétale pour atteindre zéro émission nette en 2050.
Les crédits carbone, un mécanisme de plus en plus répandu
« Certaines études montrent que ces solutions contribuent efficacement à l’adaptation aux changements climatiques avec un rapport intéressant entre leurs coûts et les différents bénéfices apportés », indique l’UICN dans son rapport intitulé « Les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux changements climatiques ». Aujourd’hui, les mécanismes de compensation séduisent de plus en plus les entreprises à fort impact environnemental. À titre d’exemple, le géant Microsoft souhaite atteindre la neutralité carbone en dix ans. « D’ici 2030, Microsoft aura atteint un bilan carbone négatif, et d’ici 2050, nous aurons retiré de l’environnement tout le carbone que nous avons émis de manière directe ou par notre consommation électrique depuis notre fondation en 1975 », a annoncé Microsoft dans un communiqué paru l’année dernière. Et pour y parvenir, l’entreprise compte notamment sur « l’afforestation » et le « reboisement ».
Lire aussi : 200 climatologues appellent à des actions fortes, rapides et à grande échelle
Cette même initiative a été présentée par les producteurs d’énergie, tels que Shell, Banque Populaire, ENI… Récemment, TotalEnergies a lancé une opération de plantation de 40 millions d’arbres en dix ans sur 40.000 hectares en République du Congo. Situé dans la zone du Bassin du Congo, ce pays abrite une partie de la deuxième forêt tropicale du monde. Mais près de 500,000 hectares de forêts primaires ont été détruits sur le territoire.
Selon Mark Carney, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, le marché de la compensation carbone « pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030, contre 300 millions en 2018 ». Mais cette croissance s’effectuerait au grand dam des défenseurs de l’environnement. Survival International, Greenpeace, ou encore les peuples autochtones eux-mêmes, soulèvent des « abus » et dénoncent une « arnaque » face à la lutte contre le réchauffement climatique.
Les ONG dénoncent de « fausses solutions »
Plusieurs associations de défense de la nature estiment que la reforestation est une « aberration ». Parmi elles, Survival International dénonce de « fausses solutions » et de « réels problèmes pour les peuples autochtones et les communautés locales ». Pour Fiore Longo, directrice de Survival France et Espagne, la reforestation dans un pays étranger est trop souvent industrialisée. Elle nuirait aux communautés locales. « L’idée de planter n’importe quel type d’arbres et n’importe où représente une violence envers les peuples autochtones, déplore-t-elle. Ce sont souvent des arbres industriels à haute croissance qui vont être coupés pour produire et cela relâche tout le carbone. En plus de cela, ils prennent feu très rapidement ».
Ces vastes monocultures d’arbres à croissance rapide favoriseraient alors les risques d’incendie et dégraderaient les écosystèmes. Laurence Tubiana, architecte de l’Accord de Paris, évoque quant à elle une possibilité de greenwashing. « La recherche montre que les compensations aujourd’hui ne génèrent aucune réduction d’émissions substantielle », met-elle en garde.
Compensation ou solution fondée sur la nature?
Auteur de l’étude Finance verte et biodiversité, les dérives d’un marché des « droits à détruire la nature », Frédéric Hache, directeur du think tank belge Green Finance Observatory, nie le terme de solution qui remplace selon lui le mot « compensation« . « C’est toujours la même histoire, on ne change pas de mode de vie dans les pays riches et on achète des terres dans les pays pauvres pour planter quelques arbres et dire que ça compte », soutient l’expert en finance durable. Il cite notamment les engagements récents effectués par le Canada pendant la COP26.
Pour lutter contre le changement climatique, « le Canada affectera au moins 20% de son engagement financier pour le climat de 5,3 milliards de dollars à des solutions fondées sur la nature (…) dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années. Ceci représente plus de 1 milliard de dollars canadiens », a annoncé la gouvernance canadienne dans un communiqué. L’objectif apparaît alors comme une évidence pour Frédéric Hache. « Cette COP est vraiment plus que toutes les précédentes une COP de financement pour le climat ou la nature », insiste-t-il.
Lire aussi : Les aires protégées nuisent-elles aux peuples autochtones?
« Une forme de colonialisme vert à grande échelle »
Frédéric Hache va encore plus loin. « Tout cet agenda autour des solutions fondées sur la nature et des compensations sert à détourner la conversation autour de la réduction d’émissions pour créer de nouvelles opportunités de business. Cette politique de finance climatique dirigée vers les pays en voie de développement est une forme de colonialisme vert à grande échelle« , soutient le directeur de Green Finance Observatory.
Démontrant que ces Sfn sont financées par des compensations carbone, il rappelle que « d’après une étude de la Commission européenne, 85% des projets compensation carbone sont un échec ». L’expert souligne également que cette compensation carbone serait « intégrée à la taxonomie européenne », c’est à dire la liste de toutes les activités considérées comme « vertes » par la Commission européenne. « Dans la mesure où cette taxonomie inclut ces Sfn, ces compensations, ça veut dire que l’on va avoir demain des milliards d’euros qui vont aller vers ces projets là », prévient Frédéric Hache.
Un « capital vert«
En parallèle, l’expert alerte sur ce qu’il appelle le « capital vert ». « C’est une conception très spéciale de la nature. Celle-ci devient comme un ensemble de services qui contribue au bien être humain ». Ainsi, une rivière peut être reconceptualisée comme un service de pêche, au même titre que la forêt peut servir de séquestration du CO2. « Si aucun humain n’habite à proximité, il n’y a pas de bénéficiaire, donc aucun service n’est proposé, éclaire Frédéric Hache. C’est donc une reprise à 0 pour les détruire gratuitement ».
Cette approche serait, selon lui, « en plein essor » puisque adoptée par l’Union Européenne. L’union possède par ailleurs un capital naturel estimé à 234 milliards d’euros par la Commission européenne. « Ce chiffre correspond plus ou moins à un mois de revenu du secteur pétrolier et gazier mondial, continue Frédéric Hache. Est–ce que le fait de produire ce chiffre aide à préserver la nature ou, à contrario, est ce que cela peut faciliter sa destruction dans la mesure où c’est peu cher de la détruire ? ».
Ce débat, grand absent des discussions selon Survival International, a été mis en avant à l’ouverture de la COP26. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé la création d’un « groupe d’experts » chargé de proposer des normes pour mesurer les engagements des acteurs non-étatiques autour des objectifs de neutralité carbone. Les détails sont encore attendus.
Sophie Cayuela