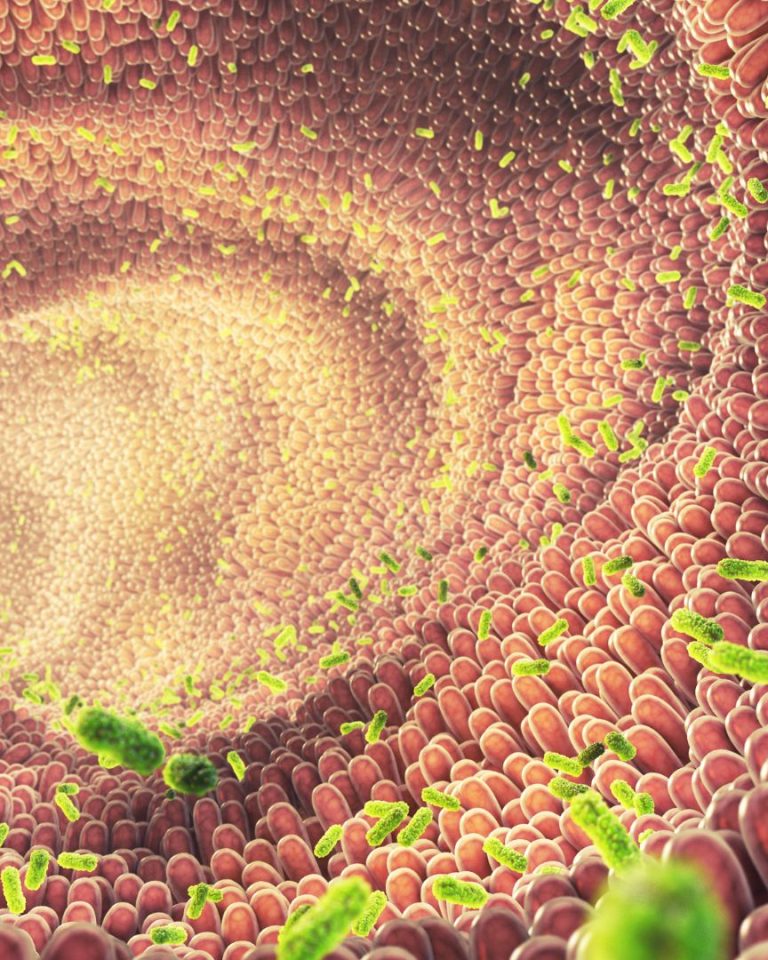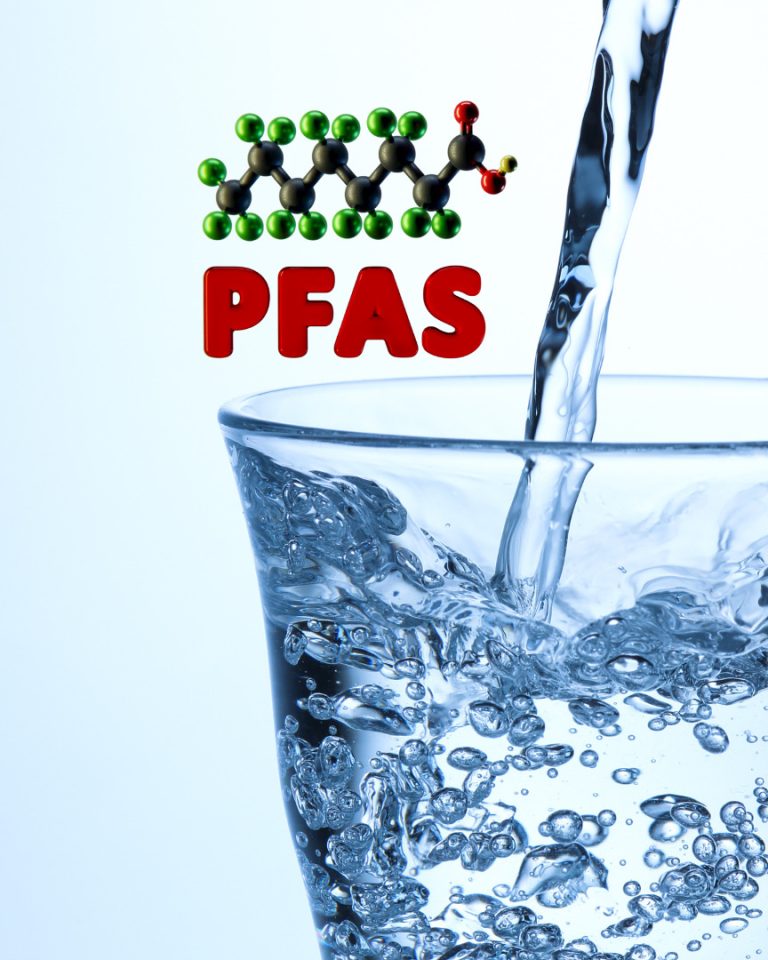Ces dernières années, des centaines de coopératives citoyennes de production énergétique ont vu le jour en France avec une idée en tête : produire localement et différemment. En mettant en place des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, elles prônent un système alternatif, décentralisé et non-capitaliste, devenant un formidable relai de sensibilisation aux questions environnementales.

En France, ce n’est un secret pour personne, l’électricité c’est plutôt l’État qui gère. Avec 57 réacteurs nucléaires en activité, et un mix électrique dominé par ce type d’énergie, on imagine mal un modèle décentralisé géré par les citoyens eux-mêmes. Et pourtant, sur tout le territoire, des irréductibles Gaulois se forment en coopératives citoyennes d’énergie. Les premières ont vu le jour dans les années 90, mais une date a marqué un point de bascule historique : 2010.
L’électricité comme bien commun
« 2010, c’est le moment où l’État a ouvert le marché de l’électricité à la concurrence, explique Béatrice Delpech, directrice générale d’Enercoop, un fournisseur coopératif d’électricité d’origine renouvelable dont 70 % de ses achats d’électricité viennent de projets à gouvernance locale. Nous nous sommes dit que c’était une fort mauvaise idée de laisser la main aux capitalistes sur cette question, car pour nous, l’énergie est un bien commun. » Alors des réseaux se sont structurés, des citoyens ont investi seuls ou avec des collectivités pour acquérir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou même des méthaniseurs.
« Il faut vraiment imaginer des personnes diversement engagées sur un territoire et qui se mettent ensemble parce qu’elles trouvent que l’idée de produire soi-même de l’énergie a du sens », décrit Béatrice Delpech. Les projets consistent par exemple à couvrir de panneaux solaires un toit ou une friche. « Quand on voit un champ d’éoliennes, on voit pas directement à quoi ça sert. Mais quand on fait partie d’un projet citoyen, qu’on a personnellement investi 100, 200 €, et qu’on a collectivement décidé ce qu’on allait faire de l’énergie produite on se sent directement concerné et on comprend l’utilité », poursuit-elle.
Un label pour soutenir la filière des coopératives citoyennes
Aujourd’hui en France, 398 projets d’énergie citoyenne ont obtenu le label Energie partagée. L’association du même nom encadre ce dernier qui structure le réseau de coopératives, et est soutenu par l’Ademe pour permettre le développement de ces initiatives locales.
Avec un certain succès : le nombre de coopératives a presque doublé en cinq ans. En 2020, seules 214 d’entre elles étaient sur pied. Le label vient en contrepartie de certaines exigences : au moins 40 % du capital investi doit venir des citoyens, la gouvernance se partage entre les acteurs, et les normes environnementales doivent être strictement respectées.
Lire aussi : 3 questions fondamentales pour choisir son fournisseur d’électricité verte
En 2024, les coopératives détentrices de ce label ont produit 1.627 gigawattheures (GWh) d’électricité, soit la consommation électrique d’1,36 million de personnes selon Energie partagée. Des panneaux solaires qui convertissent l’énergie solaire pour chauffer directement l’eau ajoutent 121 GWh d’énergie thermique à ce mix.
Petit poucet deviendra grand ?
Ces chiffres restent assez faibles, comparés à la production d’électricité d’origine renouvelable en France. En 2023, elle s’élevait à 148 TWh térattheures (TWh) selon le bilan électrique de RTE, ce qui ramène la production des coopératives labellisées à environ 1,1 % de la production renouvelable française. Et sans changement structurel, cette proportion devrait encore baisser, car la croissance du nombre de coopératives ne suit pas celle de l’investissement dans les renouvelables de géants privés comme Totalenergies ou Engie, qui ont pu mobiliser ces dernières années des sommes d’argent colossales.
« C’est vrai que c’est paradoxal de voir une si faible proportion des coopératives du côté français, car si on regarde en Allemagne, plus de 30 % de la puissance installée des énergies renouvelables provient des citoyens », note Philippe Hamman, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Pour lui, la différence vient bien sûr d’un modèle allemand plus décentralisé, qui donne historiquement plus de pouvoir aux communes. « Un autre point, c’est qu’en Allemagne les coopératives sont pensées directement pour être viables. En France, les coopératives sont relativement dépendantes d’une aide au départ de l’État, ou du tarif de rachat de l’électricité. »
Que peut faire l’État pour favoriser les coopératives citoyennes ?
Car malgré des coûts d’investissement et d’entretien très fixes, l’énergie produite par les coopératives est revendue sur le marché de l’électricité, ce qui entraine une fluctuation importante des prix et un manque de lisibilité à moyen et long terme pour ces petites entités. « C’est un des freins au développement plus important de ce type de coopératives », selon Béatrice Delpech.
« Ce qu’on voudrait, ce sont des contrats où on achète sur 20-30 ans l’énergie d’un producteur, continue-telle. Ne pas se calquer sur les prix du marché, mais bien sur le coût de production réel que les coopératives doivent payer. » De tels contrats existent en France, les contrats dits « de gré à gré ». Mais pour l’instant, ils sont surtout réservés aux grands industriels. Un accord a par exemple été signé, le 28 janvier 2025, entre TotalEnergies et STMelectronics, une multinationale qui commercialise des puces électroniques. Il prévoit la vente sur 15 ans d’1,5 TWh d’électricité chaque année en provenance d’immenses fermes solaires de TotalEnergies. « On voit bien ici qu’il y a un enjeu à démocratiser ces contrats pour tous, particuliers, TPE, PME, collectivités au-delà des seuls industriels », décrit Béatrice Delpech.
L’argument local
Pour les partisans des coopératives, s’il est loin d’être majoritaire, leur modèle n’est pas obsolète pour autant. Ils mettent en avant l’aspect local de ces projets, capables de s’adapter aux territoires et de développer l’économie circulaire. Un rapport d’Energie partagée et de l’Ademe, publié en 2019, montrait que pour 1 € investi dans un projet coopératif, 2,5 € profitaient au territoire. Selon ce même rapport, les projets citoyens sont deux à trois fois plus rentables pour le territoire que les projets privés.
Et le rayonnement ne s’arrête pas à l’aspect économique. Un autre rapport, cette fois-ci publié par la branche occitane de l’Ademe, montrait qu’en moyenne un projet impliquait 200 actionnaires-citoyens, et sensibilisait 1400 personnes aux questions de transition énergétique. « Notre objectif est de lancer une coopérative dans chaque intercommunalité de France, explique Catherine Graton, responsable communication et partenariats d’Energie partagée. Ce qui permettra de créer un maillage territorial suffisant pour impliquer les personnes dans cette transition énergétique absolument nécessaire pour faire face à l’urgence climatique. »