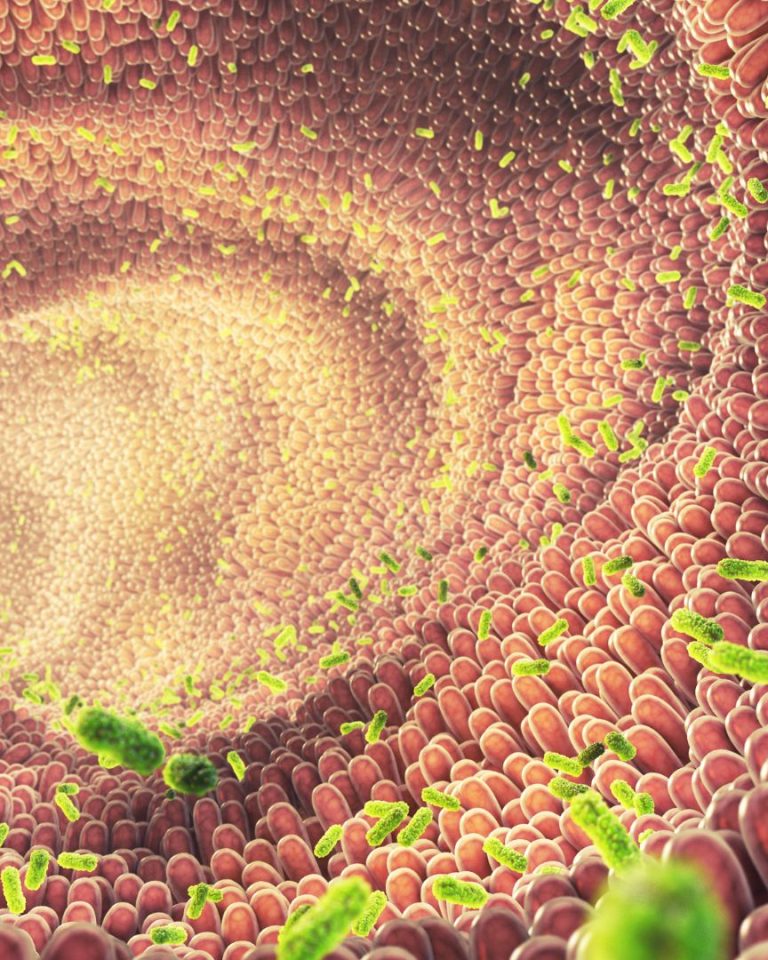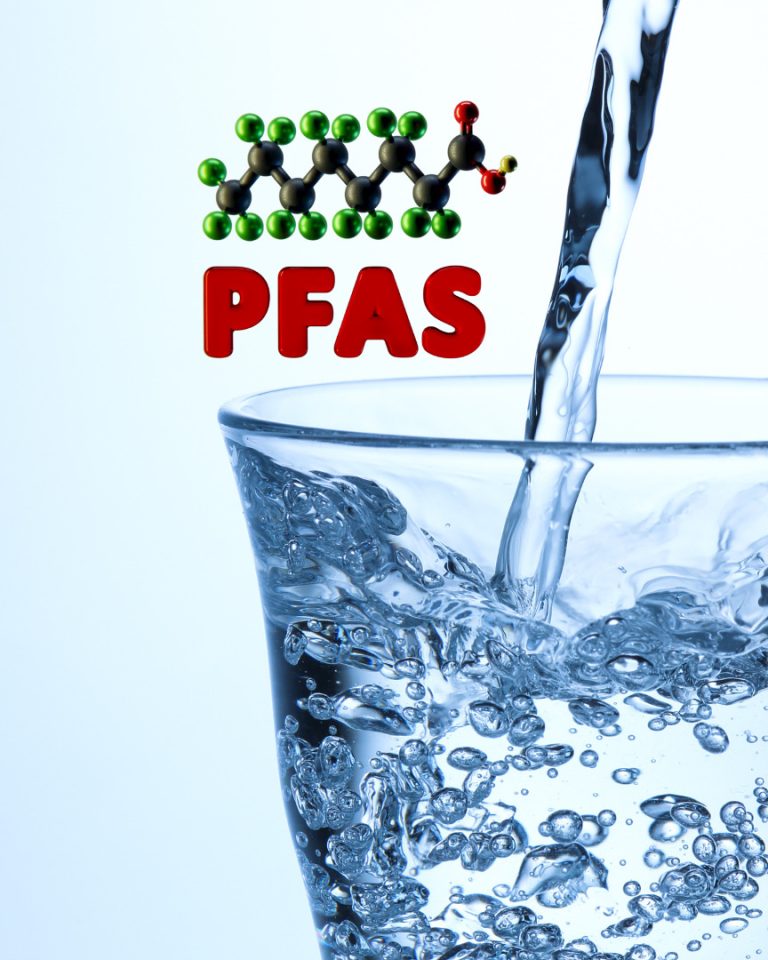Près de la moitié des terres agricoles françaises produisent pour l’exportation, selon un rapport de l’association Terre de liens publié lundi 17 février. Cette situation force le pays à importer massivement des produits agricoles et favorise la précarité alimentaire, mettant à mal les discours sur la « souveraineté alimentaire » que prône le gouvernement.

« Plus on exporte, plus on importe. » En une phrase, la chargée de plaidoyer Caroline Sovran résume le rapport publié par l’association Terre de liens, ce lundi 17 février. Depuis 2003, ce mouvement citoyen reconnu d’utilité publique œuvre à préserver les terres agricoles et un modèle paysan. Chaque année depuis cinq ans, l’association publie un rapport sur l’accaparement des terres par les firmes agro-industrielles. Dans son viseur aujourd’hui, « l’absurdité du système alimentaire mondialisé » qui pousse à importer massivement les produits que l’on consomme en France. Cette situation mettrait en danger la « souveraineté alimentaire » du pays.
Un scandale made in France
Théoriquement, la France est largement autonome sur le plan agricole. Avec 28 millions d’hectares de terres cultivables, la plus grande surface agricole européenne, son potentiel nourricier est de 130 %. Traduction : elle peut nourrir 1,3 fois la population nationale. Mais en réalité, ce n’est pas l’agriculture française qui nourrit les Français. 44 % des terres cultivables produisent pour exporter des marchandises vers d’autres pays, en vertu de la trentaine d’accords de libre-échange signés par l’Union européenne. Au final, la France doit donc importer 33 % des produits qu’elle consomme. « Nos importations mobilisent près de 10 millions d’hectares aux quatre coins du monde. Une surface équivalente à la taille de l’Islande », détaille Caroline Sovran.
Pour l’association Terre de liens, cette situation est un « scandale made in France » favorisé par l’État et l’Union européenne. Ils se serviraient de la Politique agricole commune (PAC) pour servir les grandes exploitations industrielles au détriment d’un modèle paysan plus respectueux de l’environnement. « Ce système sous perfusion est la conséquence de plusieurs décennies de politiques agricoles et commerciales à contre-courant, qui préfèrent l’exportation à la consommation locale et l’agro-industrie à l’agroécologie », peut-on lire dans le rapport.
Lire aussi : Climato-intelligence ou agroécologie : quel avenir pour l’agriculture ?
La France, une grande puissance agricole sans souveraineté alimentaire ?
Mais alors, quel intérêt ? Est-ce que ce système tourné vers l’exportation fait de la France une grande puissance agricole, avec une balance commerciale positive ? À première vue, oui. En 2023, selon un rapport de France Agrimer, la France était le sixième pays exportant le plus de produits agricoles au monde. C’est le troisième en Europe, derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. La balance commerciale apparaît encore positive, enregistrant + 5,3 milliards d’euros en 2023.
Ce chiffre cache néanmoins deux sujets. D’abord, les vins et spiritueux expliquent en grande partie ce solde positif, puisqu’en 2023 la balance commerciale de ce secteur était de plus de 13 milliards d’euros. En l’excluant des calculs, la balance commerciale agricole de la France est déficitaire de plus de 8 milliards. Des secteurs comme l’élevage sont particulièrement concernés, alimentant la crise agricole actuelle et la colère des éleveurs. « On pourrait se consoler en se disant que ça fait de nous une puissance agricole. Mais en fait même pas », dénonce Caroline Sovran.
Des coûts non pris en compte ?
Pour les auteurs du rapport, l’agriculture industrielle tournée vers l’exportation est aussi problématique, car elle pousse les exploitations à se spécialiser de façon industrielle. Le nombre de fermes n’ayant qu’un seul type de production agricole a explosé en quelques années, passant de 19 % des fermes en 1990 à 35 % aujourd’hui.
Cette agriculture industrielle est largement dépendante des intrants chimiques comme les engrais minéraux ou les pesticides. Ces produits importés massivement de pays situés en dehors de l’Union européenne comme la Russie, le Maroc, l’Algérie ou l’Égypte, n’apparaissent toutefois pas dans la balance commerciale.
La France consomme pourtant chaque année 8,5 millions de tonnes d’engrais minéraux, pour un coût estimé par le ministère de l’Agriculture à 5,7 milliards d’euros. Terre de liens alerte : « Notre consommation d’engrais nous rend ainsi triplement dépendants : à des ressources minières, au gaz, dont le prix volatile impacte directement l’agriculture, et aux pays tiers qui en disposent ».
La souveraineté alimentaire, une notion à repenser ?
Depuis quelques années, le gouvernement français utilise la carte de la souveraineté alimentaire à chaque discours sur l’agriculture. La loi d’orientation agricole (LOA) qui arrive mardi 18 février à la fin de son parcours législatif envisage même de nombreux reculs sur la protection de l’environnement au nom de cette même « souveraineté alimentaire », en l’inscrivant dans la loi comme « intérêt majeur de la nation ».
Pour l’association Terre de liens, cette opposition entre souveraineté alimentaire et protection de l’environnement n’a aucun sens. Elle accuse l’État de s’être réapproprié la notion et de choisir une définition trop restrictive. « Le seul critère pris en compte est la balance commerciale. Comme si importer tous les produits de première nécessité pour exporter du vin nous rendait souverains ? À quel moment les Français ont été démocratiquement consultés pour consacrer autant de terres à l’exportation ? », plaide Coline Sovran.
Un retour à la définition d’origine
Terre de liens propose au contraire de revenir à la définition originale de la notion de souveraineté alimentaire. En 1996, le mouvement paysan Via Campesina la décrivait ainsi : « Un droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires ».
L’association fait donc des propositions pour « construire un système agroalimentaire juste et durable ». Pêle-mêle, on y retrouve la réorientation de la Politique agricole commune (PAC) « vers une sortie de l’agriculture chimique », la démocratisation du système alimentaire par la participation citoyenne ou encore le renforcement du pouvoir des collectivités territoriales pour agir pour l’alimentation durable.
« 18 % des agriculteurs sont aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, et des millions de personnes sont en état de précarité alimentaire, prévient Coline Sovran. Lors des manifestations des agriculteurs, les slogans ce n’était pas ‘laissez-nous exporter’. C’était ‘laissez-nous avoir un salaire décent’. Si on ne change pas la manière dont on s’alimente, nous n’aurons plus de terres pour nous nourrir. »