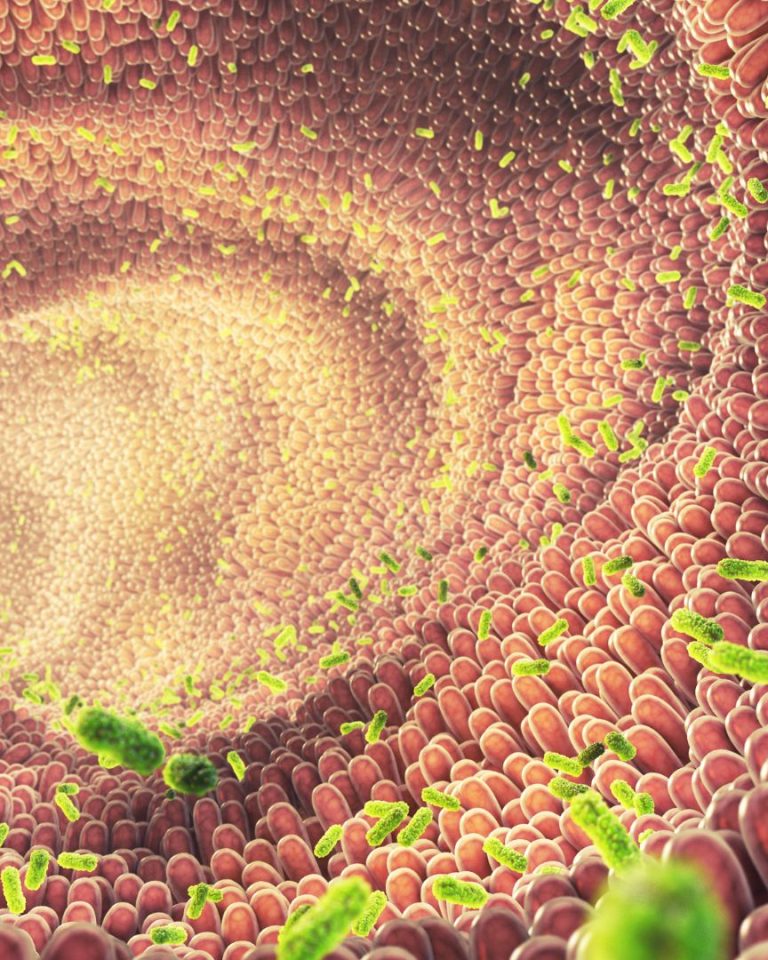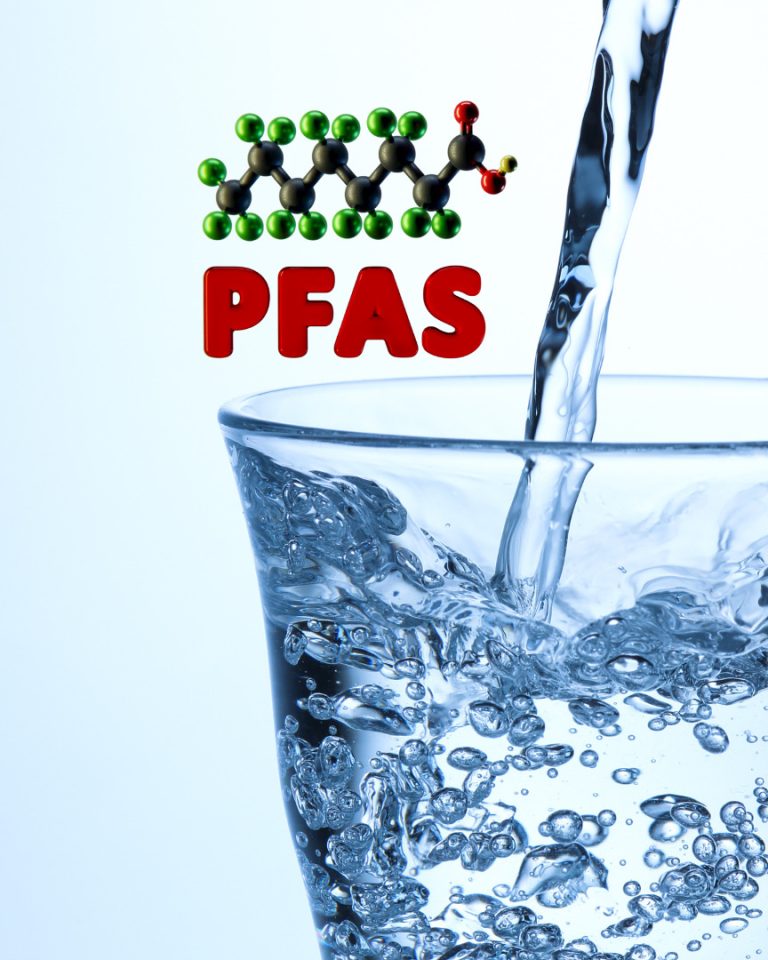Depuis 2023, des scientifiques analysent l’impact de la Caisse alimentaire commune de Montpellier. Ce dispositif, inspiré de l’idée de sécurité sociale de l’alimentation, apporte de nombreux bénéfices sur la réduction de la précarité alimentaire et le soutien aux filières biologiques.

Quand on pense à Montpellier, on imagine d’abord du soleil et des tramways fantasques, aux motifs à fleurs rouges, verts, et jaunes. Mais depuis deux ans, la ville connaît une expérience tout aussi haute en couleur. La Caisse alimentaire commune est la première expérimentation mondiale grandeur nature de sécurité sociale de l’alimentation, un dispositif inspiré de la sécurité sociale de la santé.
Tout tourne autour de la MonA, une monnaie virtuelle calquée sur l’euro à dépenser dans des supermarchés bios ou même directement chez les producteurs locaux. Concrètement, depuis 2023, 380 cotisants reçoivent 100 MonA chaque mois. Soit 100 euros donc. Les cotisations des particuliers financent 50 % du dispositif, l’autre moitié de l’argent provient des collectivités.
Des résultats très positifs en faveur de l’égalité et de l’écologie
Depuis deux ans, des scientifiques se sont donc penchés sur l’impact concret de l’expérience. Dans un rapport publié en décembre 2024, ils ont constaté une nette augmentation de la qualité de l’alimentation, et un ruissellement très important sur l’économie bio locale.
« Pour la majorité des participants qui ont pris part à la Caisse alimentaire commune, on parle de profonds changements dans leur vie quotidienne, explique Grégori Akermann, co-auteur de l’étude et sociologue à l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae). Pour les personnes précaires en particulier, comme elles reçoivent plus qu’elles ne cotisent, elles se retrouvent avec une augmentation de leur pouvoir d’achat, et donc une possibilité d’accès à une alimentation de qualité. Exactement comme pour la sécurité sociale de la santé, où on permet à chacun d’avoir accès à des soins de qualité. »
82 % des achats vont aux filières bio
Lors des entretiens réalisés par le chercheur, de nombreuses personnes ont exprimé leur joie face à la possibilité de s’offrir enfin des produits frais et bons pour la santé. « 82 % des 400.000 MonA qui circulent chaque année sont utilisés directement pour acheter des produits issus de l’agriculture biologique, et 20 % pour des fruits et légumes frais », souligne Gregori Akermann.
Un coup de pouce bienvenu pour les commerces équitables et locaux. Les enseignes conventionnées où les personnes peuvent dépenser leur MonA ont vu leur chiffre d’affaire augmenter de 2 à 7 %, alors que le dispositif concerne aujourd’hui à peine 380 personnes. « Ce soutien aux commerces de proximité via le conventionnement, c’est tout l’intérêt du principe de sécurité sociale de l’alimentation, poursuit Gregori Akermann. Dans d’autres dispositifs où on se contente de distribuer des bons alimentaires pour lutter contre la précarité, on se rend compte que ça profite essentiellement à des grandes enseignes comme Carrefour ou Leclerc, ce qui n’est pas forcément souhaitable si on veut favoriser les circuits-courts. »
Lire aussi : « Un scandale made in France » : l’export menace la souveraineté alimentaire
Un laboratoire démocratique
Mais comment sont choisis les établissements conventionnés ? « À Montpellier, nous avons laissé un grand pouvoir à un comité citoyen de 61 personnes », détaille Marie Massart, adjointe au maire de Montpellier déléguée à la politique alimentaire et à l’agriculture urbaine. Concrètement, cette assemblée a presque tout pouvoir sur l’expérience. C’est elle qui a déterminé le niveau de cotisation requis, les critères de convention pour les enseignes, ou encore s’il faut des justificatifs.
« On parle quand même d’un budget de 400.000 euros, dont la moitié vient des collectivités, qu’on met entre les mains des citoyens », met en avant Marie Massart. Les résultats de cette expérience démocratique ont impressionné l’élue écologiste. « L’assemblée a d’elle-même choisi de conventionner presque uniquement des commerces locaux et bio, et d’accentuer la dimension sociale de l’expérience. En tant que décideuse publique, les discussions qui ont eu lieu m’ont fait évoluer sur ce que je voulais mettre en place. »
Quelles limites à la sécurité sociale de l’alimentation ?
Une telle expérience grandeur nature ne vient pas sans obstacles. « Nous nous sommes rendus compte qu’au début, les personnes précaires ne se sentaient pas forcément à leur place dans des établissements comme la Biocoop ou les épiceries bio, remarque Gregori Akermann, sociologue à l’Inrae. Ce sont des endroits éloignés des quartiers populaires, et fréquentés par une clientèle beaucoup plus aisée que la moyenne. » Loin d’être insurmontable, ce défi doit être pris au sérieux pour le chercheur.
Autre souci, l’expérience voulait mettre en contact directement les consommateurs et les producteurs locaux. Mais chassez le naturel, il revient au galop, et force est de constater que les participants préfèrent des établissements disposant d’un grand nombre de choix et ouverts toute la journée. « Les dépenses de MonA ont été faites pour 42 % à la Cagette, un supermarché coopératif en centre-ville, et pour 25 % à la Biocoop, détaille Gregori Akermann. Les producteurs sur les marchés n’ont capté que 12 % de la MonA émise, et les autorités travaillent pour voir comment rééquilibrer cette balance. »
Une vocation universelle, à étendre au niveau national ?
L’expérience de Montpellier ne compte pas s’arrêter là. « Nous avons un calendrier d’extension du dispositif jusqu’en 2029, explique Marie Massart. Et comme pour la sécurité sociale de la santé, la sécurité sociale de l’alimentation a une vocation universelle, donc nous espérons qu’un jour tout le monde pourra en profiter. »
En 2025, la Caisse alimentaire commune passera à 600 bénéficiaires. Cela représente un budget de 800.000 euros, dont 400.000 viennent des cotisations des participants. Et d’ici 2029, la mairie prévoit une intégration de 1.200 foyers. Les élus locaux espèrent ainsi pouvoir diminuer la précarité alimentaire, dans une métropole de 500.000 habitants où 28 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
L’expérience de Montpellier, ainsi que la quarantaine de dispositifs similaires qui ont vu le jour en France depuis deux ans, trouvent des adeptes jusque sur les bancs de l’Assemblée nationale. « La sécurité sociale de l’alimentation a le potentiel de changer complètement la société, pour aller vers plus d’écologie, plus d’égalité sociale et une meilleure santé » s’enthousiasme le député écologiste du Rhône Boris Tavernier. Jeudi 20 février, il présentait à l’Assemblée nationale une proposition de loi pour soutenir une expérimentation nationale de sécurité sociale de l’alimentation. Il n’y a finalement pas eu de débat sur le texte, manque de temps dans la niche parlementaire écologiste. « C’est dommage, mais comptez sur moi pour ne rien lâcher », confie l’élu.