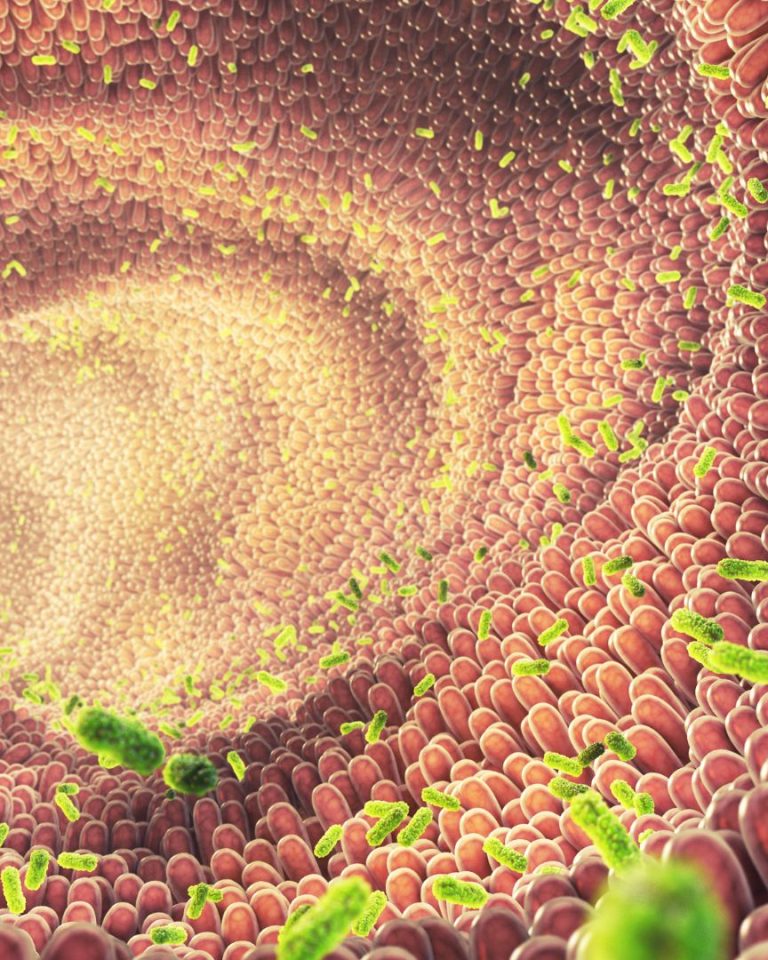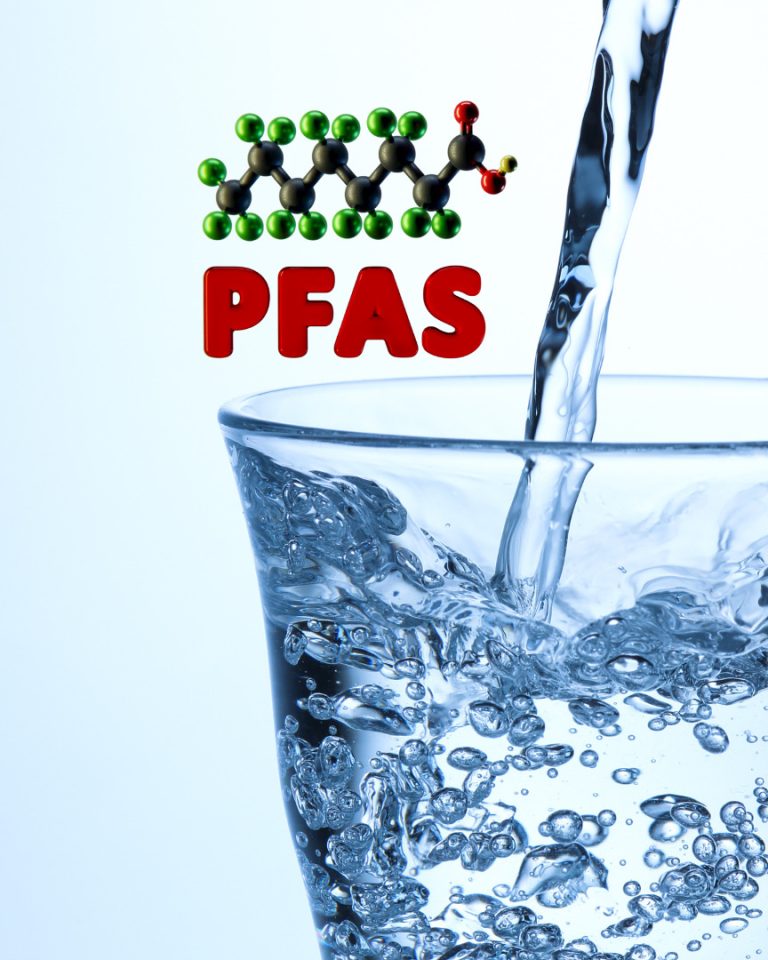L’épidémie de coronavirus met au grand jour l’extrême fragilité de nos sociétés face aux crises. Les associations membres du Réseau Action Climat appellent à prendre des mesures fortes pour rendre nos sociétés plus résilientes face aux crises, notamment la crise climatique. Entretien.

Le Réseau Action Climat formule ses propositions pour l’après-crise sanitaire. Objectif : éviter une crise économique, financière et sociale sur le court-terme et construire une société résiliente aux crises climatiques et à la perte de la biodiversité sur le moyen-terme. Un changement de cap économique s’invite dans le débat pour stopper la destruction de la biodiversité et des espaces naturels et mettre fin à la « mondialisation accélérée » et « aux délocalisations massives ».
Sur la table, le plan de sauvetage d’urgence ne devra pas aggraver la crise climatique et l’érosion de la biodiversité. Il devra notamment s’orienter vers la prévention de faillites de grande ampleur. Le Réseau Action Climat appelle à plusieurs conditionnalités des aides, notamment le respect des budgets carbone et la mise en place d’un moratoire sur le versement des dividendes. L’ONG prône la mise en place d’une économie et d’une société plus résilientes et plus justes. Elle appelle à un nouveau cadre économique pour libérer les capacités d’investissements pour la transition. Lucile Dufour, responsable des Politiques internationales du Réseau Action Climat fait le lien entre la crise actuelle et la crise climatique à venir.
Natura Sciences : Quels liens pouvons-nous faire entre la crise actuelle et la crise climatique?
Lucile Dufour : La crise climatique a beaucoup de similitudes avec la crise actuelle. Notamment, elle n’a pas de frontières et elle va devoir être réglée grâce à la coopération internationale. Les pays doivent comprendre que la crise du Covid-19 souligne toutes les vulnérabilités de notre société et de son manque de résilience face aux chocs. Or, le choc lié à la crise climatique sera extrêmement fort et touche déjà nos sociétés.
La crise du Covid-19 doit être l’occasion de réfléchir à la façon dont nos sociétés répondent à ces vulnérabilités et comment elles construisent la résilience sur le long-terme. Cela ne concerne pas que la résilience climatique, mais aussi la résilience sociale, celle du service public ou encore celle du système de santé. La réflexion autour de la résilience face au réchauffement climatique doit s’ancrer dans le débat, car le consensus scientifique montre qu’un choc extrême va toucher notre société dans les 5 à 20 prochaines années. Les plans de sortie de crises doivent donc impérativement intégrer cette question de la résilience climatique.
La COP26 a été reportée à 2021, mais cela ne veut certainement pas dire qu’il faut repousser l’action climatique d’un an. Les pays doivent toujours préparer les plans climatiques nationaux – les NDC – qu’ils s’étaient engagés à rendre cette année. Mais en plus, ils doivent veiller à ce que la réponse à la crise sanitaire n’exacerbe pas d’autres crises, notamment celle du climat. Les plans d’urgence face à la crise sanitaire et les plans de relance pour soutenir l’économie doivent ainsi intégrer la question de la résilience écologique. Cela passe par les investissements verts pour les rendre plus résilientes dans le temps face aux chocs et lutter contre le dérèglement climatique.
Lire aussi : Coronavirus : une crise économique pire que 2008 se prépare
Que doivent mettre en place nos sociétés pour plus de résilience?
En France, nous avons déjà élaboré des propositions pour une plus grande résilience face aux crises. Sur le court-terme, cela passe par exemple par le fait que les plans d’urgence de soutien aux grandes industries polluantes en difficulté intègrent des conditionnalités et soient transparents. C’est le cas par exemple dans le secteur de l’aviation et de l’automobile.
Sur le moyen et le long-terme, il y a beaucoup de pistes de réflexion. En particulier tout ce qui concerne les relocalisations. Cette crise montre que la mondialisation nous a rendu plus vulnérables, car nous sommes extrêmement inter-dépendants. Il faudra relocaliser une certaine partie des industries comme l’industrie textile et relocaliser une partie de la production agricole. Il faudra réaliser cela tout en faisant en sorte que ces productions appliquent les normes environnementales de plus en plus exigeantes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre territoriales et nos émissions importées.
Les plans de relance pourront-ils se passer du social et de l’environnement?
La question de la justice sociale et environnementale des plans de relance sera aussi être très importante dans le contexte social actuel. Et bien sûr, il faut considérer tout ce qui permettra de réformer en profondeur notre système économique et financier pour se préparer à d’autres chocs à venir. Comment faire pour que les institutions publiques financières s’alignent sur les objectifs de l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable? Comment faire pour que les politiques monétaires et budgétaires ne soient pas néfastes à l’environnement? Ces considérations sont importantes.
Au-delà de ces plans de relance qui doivent intégrer la contrainte climatique, les pays doivent élaborer des plans climatiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre séparés. Cela impose aux pays de continuer à travailler sur leur NDC. Notamment, au niveau européen, le plan de relance devra s’aligner sur une ambition climatique relevée au niveau européen. À savoir une réduction de 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990. L’Union européenne devra utiliser le Green Deal comme cadre d’analyse pour construire ce plan de relance. Il y a un lien fort entre les outils pour le climat et ceux pour la relance et il faut que ce lien soit fait.
Propos recueillis par Matthieu Combe