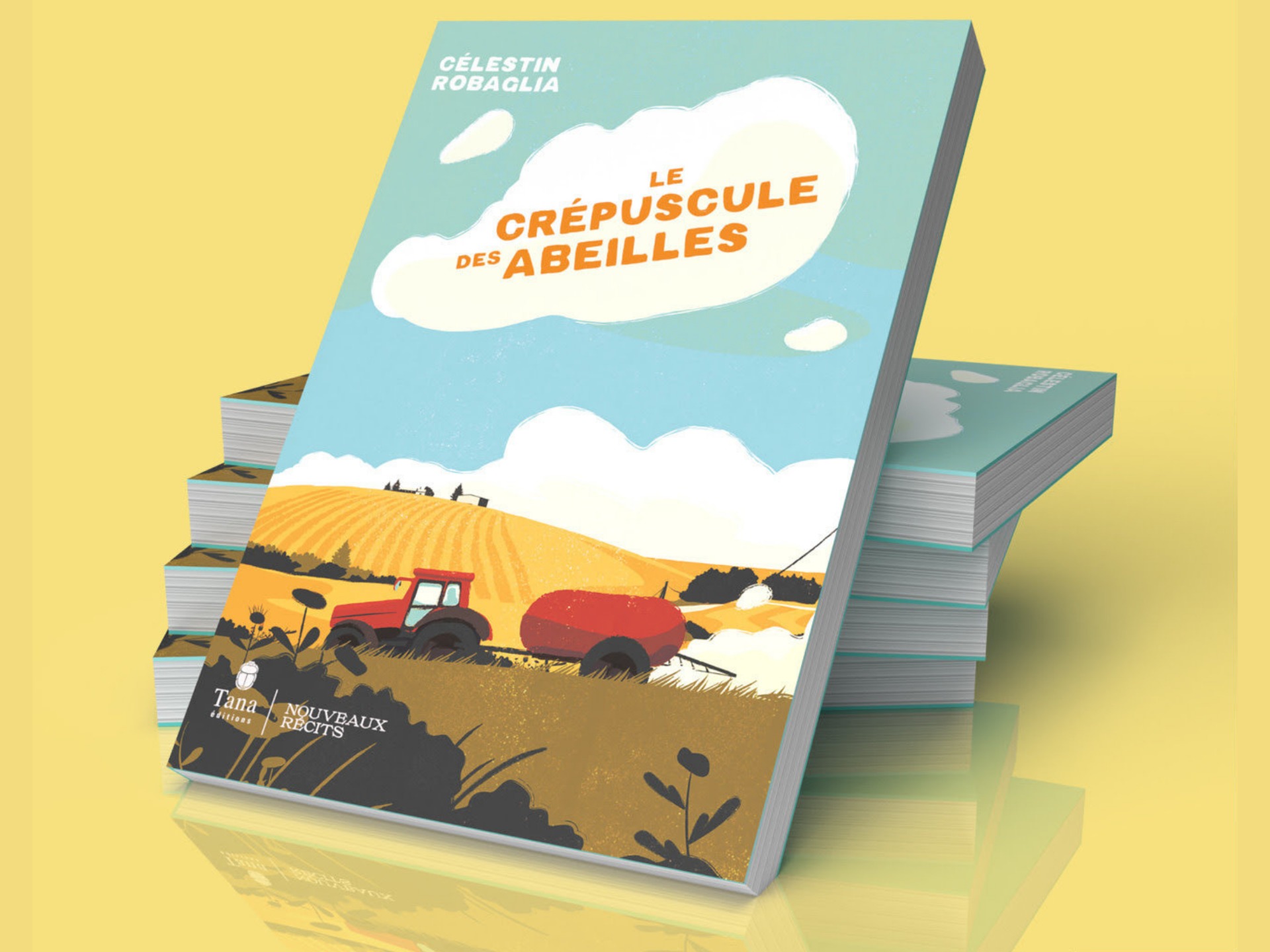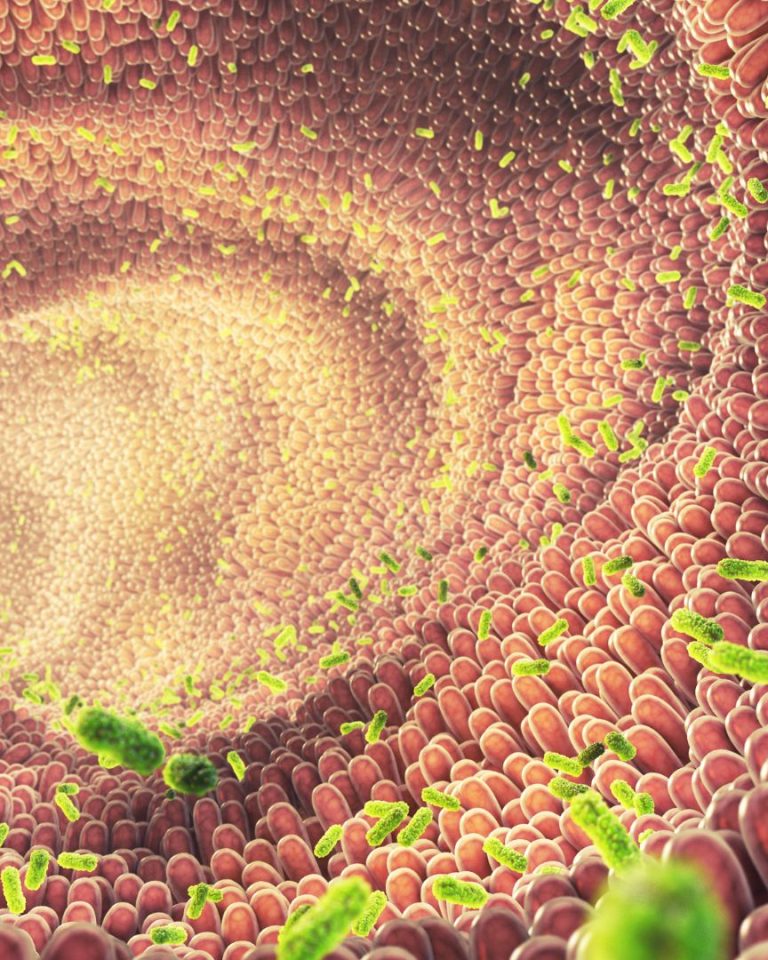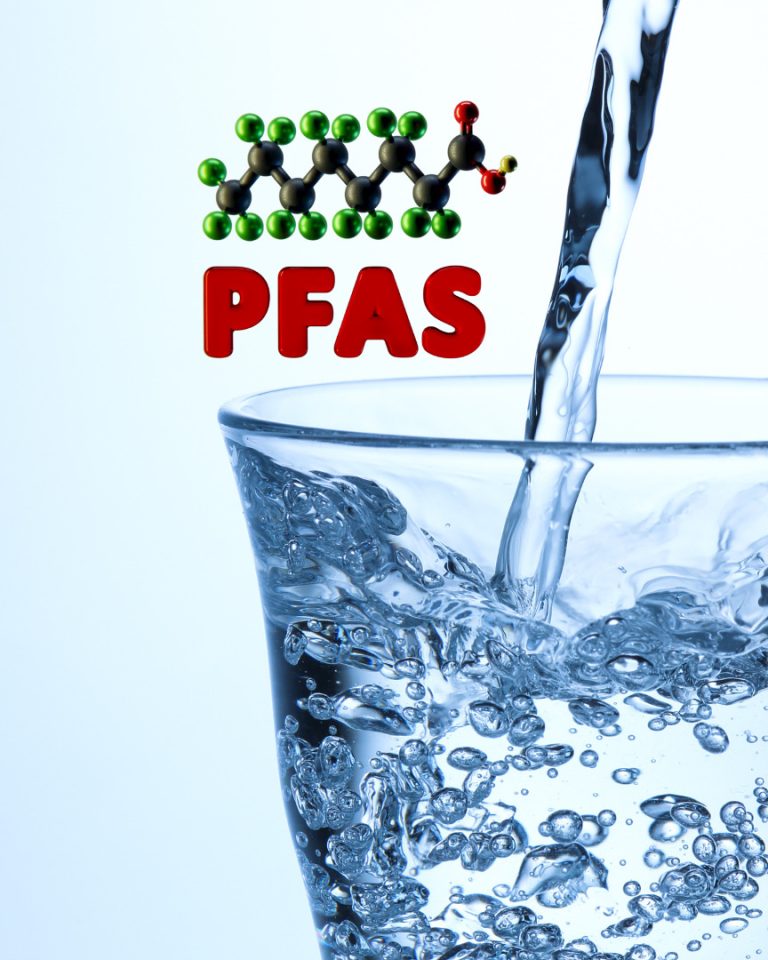L’écrivain a choisi la narration pour retracer la controverse du glyphosate. En mêlant fiction et réel, Célestin Robaglia livre son propre point de vue à travers ses personnages pour toucher et éclairer un public nouveau sur la thématique des pesticides. Entretien.
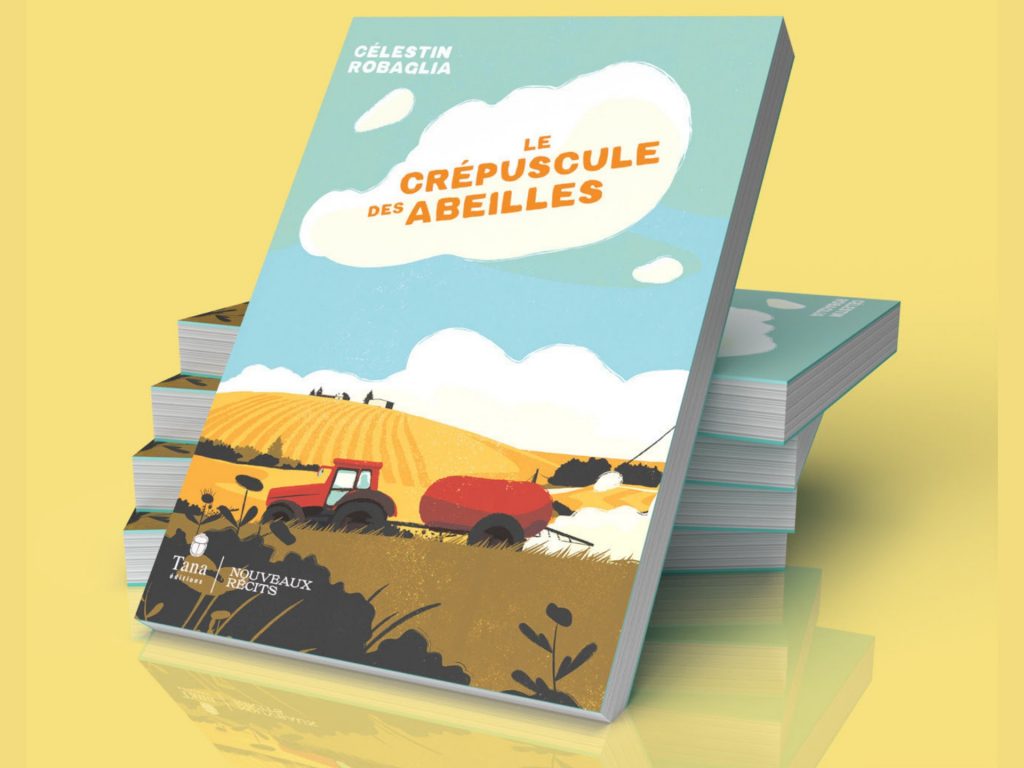

« Le Crépuscule des abeilles » ne prend la forme ni d’un essai scientifique ni d’un manifeste. Derrière son côté militant, Célestin Robaglia utilise ses talents de romancier pour livrer son propre point de vue sur l’utilisation de pesticides. Choisissant de mêler fiction et réel, l’auteur privilégie la trame narrative pour raconter le destin d’Elsa et Alice, sœurs jumelles aux caractères opposés. Malgré leurs différences marquantes, elles partagent ensemble leur engagement pour la préservation de l’environnement et l’interdiction des pesticides. Alice est apicultrice, témoin des effets néfastes des produits chimiques dans le Périgord et des néonicotinoïdes sur ses ruches. Elsa est avocate à Paris et mène un long combat juridique contre Oxol, une industrie vendant ses propres pesticides à base de glyphosate. Une députée écologiste l’accompagne avec l’espoir d’aboutir à un référendum d’initiative partagée sur cette interdiction. À travers ces péripéties, Célestin Robaglia se base sur des faits réels datant des années 2010 pour retracer la controverse autour du glyphosate. Quelques jours après la sortie du roman en librairie, Natura Sciences a rencontré son auteur à Paris.
Natura Sciences : Votre roman « Le Crépuscule des abeilles » met en narration deux sœurs qui se battent contre l’industrie des pesticides et pour l’interdiction du glyphosate. Qu’est ce qui vous a motivé à faire ce livre ?
Célestin Robaglia : Je suis très concerné par l’écologie en général. Je m’intéresse notamment à la question des pesticides depuis la parution de l’étude allemande qui a lancé le mouvement des coquelicots. Cette initiative citoyenne s’est créée sur l’idée que 80% des insectes volants ont disparu en 27 ans. Elle a pris une certaine ampleur mais elle ne dépasse pas le million de signatures [Le Manifeste du mouvement des coquelicots plaidait, entre 2018 et 2020, pour une interdiction de tous les pesticides de synthèse, NDLR]. Elle m’a permis de réaliser que l’utilisation des pesticides est une problématique clé. J’avais envie de parler et de participer au débat. Et l’idée de ce roman m’est venue, comme souvent, en me réveillant le matin. La forme est arrivée après, avec l’idée d’une structure scénaristique précise. J’ai préféré utiliser le roman populaire pour rendre la lecture fluide et facile.
D’où l’utilisation de la narration ?
Oui. Ce qui m’intéresse est de favoriser l’histoire et le message. L’aspect judiciaire du récit me permettait d’utiliser la culture populaire pour amener de l’information concrète. Quelque part, cela revient à fusionner une logique d’essai ou de documentaire avec une logique de roman pour toucher un nouveau public.
Un public qui n’est pas forcément concerné par les problèmes environnementaux par exemple ?
Ce serait bien-sûr mon espoir le plus fou. Je vise d’abord un public qui, dans mon expérience, est intéressé par l’écologie mais sous-estime le problème des pesticides. Ensuite, l’idéal serait d’élargir le cercle grâce au suspens et au rythme de l’histoire. Les individus capables de lire un essai sur les pesticides constituent une franche très réduite de la population. Ce ne sont certainement pas les climato-sceptiques qui vont lire mon roman, mais il va probablement toucher des gens intéressés par l’écologie sans que celle-ci ne soit au centre de leur vie. J’aimerais que « Le Crépuscule des abeilles » soit saisi comme un outil, politique ou civique, pour pouvoir intriguer un public plus large, sans toutefois espérer toucher tout le monde pour autant.
Lire aussi : Terre de liens appelle à repenser le modèle agricole français
Dans votre livre, les sœurs Elsa et Alice témoignent chacune d’un caractère très différent. L’une est citadine et affirmée, l’autre se montre plus calme et se réfugie à la campagne pour trouver son bien-être. En explorant deux personnalités opposées, qu’avez-vous voulu montrer ?
J’observe deux écologies qui ont du mal à se rencontrer au quotidien. D’abord l’écologie militante et politique, puis l’écologie alternative qui est très présente dans la campagne où je réside. Elsa et Alice représentent ces deux écologies qui, pour moi, sont essentielles. La première exerce la pression sur les politiques et les entreprises en réclamant des actions. J’associe la seconde au Mouvement Colibris, c’est-à-dire faire attention à ses consommations, réduire son mode de vie, etc. Je crois personnellement que l’écologie doit s’incarner dans l’éthique et dans des actes concrets. Mais cela reste insuffisant par rapport à l’ampleur de la crise écologique actuelle. Toucher le pouvoir politique est clé. Je voulais donner de la place et de la noblesse à ces deux manières de voir.
Le personnage de Maurice, le voisin d’Alice, s’alarme de la disparition des insectes en vingt ans. Exprimez-vous votre vision personnelle à travers ses mots ?
Oui. Quand j’étais petit, je me rendais à la campagne où es insectes s’écrasaient contre les pare-brise, ce qui ne m’arrive jamais maintenant. Je peux en parler car ce sont des des choses que je vivais, et que je ne vis plus désormais. Je l’ai insérée dans mon livre, car cette vision touche le bon sens plutôt que la facette scientifique des lecteurs. C’est une autre manière d’en parler.
Maurice fait partie d’une certaine génération. Mais dans votre livre, vous comparez également celle des parents des deux sœurs à la leur. La première a vécu dans « le confort et le profit », alors qu’Elsa et Alice connaissent une crise écologique. Y-a-t-il une génération plus responsable qu’une autre selon vous ?
Je pencherais plutôt pour un non. Pour les problématiques que l’on vit aujourd’hui, il fallait être visionnaire dans les années 1960 ou 1970. Je dirais qu’il y a une responsabilité des instances publiques parce que, à partir de ces années-là, un consensus scientifique est apparu sur la plupart des problèmes écologiques que l’on vit maintenant. J’ai fait très attention dans ce roman à ne pas être accusateur, si ce n’est que par rapport aux lobbies. Dans la réalité intime des personnes, les questions se posent différemment et elles ne semblent pas préoccupantes. Mon projet n’était pas de culpabiliser une partie de la population, mais d’alerter sur l’avenir invivable qui se prépare, pour nos enfants et pour nous-mêmes.
Lire aussi : Plan pollinisateurs : le nouvel arrêté protège insuffisamment les abeilles
Lors du dîner entre les deux sœurs et leurs parents, vous évoquez la « détresse » de la nouvelle génération. Ressentez-vous, comme Elsa et Alice, une inquiétude croissante sur l’avenir environnemental ?
En plus d’une augmentation de la conscience écologique, j’ai pu observer ces dernières années une augmentation de l’importance de l’anxiété par rapport au futur. Disons que pour ma part, depuis très récemment, j’ai la sensation que cela va être difficile pour notre espèce d’être à la hauteur face à une crise civilisationnelle. Notre civilisation s’est construite sur l’idée d’un monde infini et de la domination de la nature.
Vous ne mentionnez pas ces idées dans votre livre. Pourquoi ?
Mon projet, dans cette idée de roman populaire, était de ménager le lecteur. « Le crépuscule des abeilles » parle d’un sujet difficile, en amenant du concret. Je n’ai pas enfilé la posture d’Aurélien Barrau, qui invite le public à agir. La question du récit écologique est très compliquée parce qu’elle pose la difficulté d’être entendue sans en dire trop et de toucher le désespoir. J’ai essayé de trouver cet entre-deux par la tendresse entre les personnages, leur attachement et une tragédie comique. Ce n’est pas de la pure tragédie grecque.
Vous confrontez des points de vus différents tout au long du roman. Votre objectif est-il de convaincre ou d’instruire ?
Ce qui est intéressant scénaristiquement, c’est que l’on suit Elsa sur ces questions. Ce personnage se renseigne et a un parti pris, qui se trouve être le mien. Mais d’une certaine manière, il n’est pas énoncé comme une vérité absolue. J’ai vraiment cherché à comprendre comment, 45 ans après la mise sur le marché du glyphosate, il manquait toujours de la clarté du point de vue scientifique. J’ai essayé d’exposer les arguments des pro-pesticides et, bien entendu, il y a des milliers d’études aujourd’hui sur le glyphosate. C’est un point de vue très étayé mais qui ne peut prétendre à être absolu. La stratégie de ces groupes, mis en avant dans le roman, c’est de rendre impossible le fait d’avoir un point de vue absolument certain sur ces sujets.