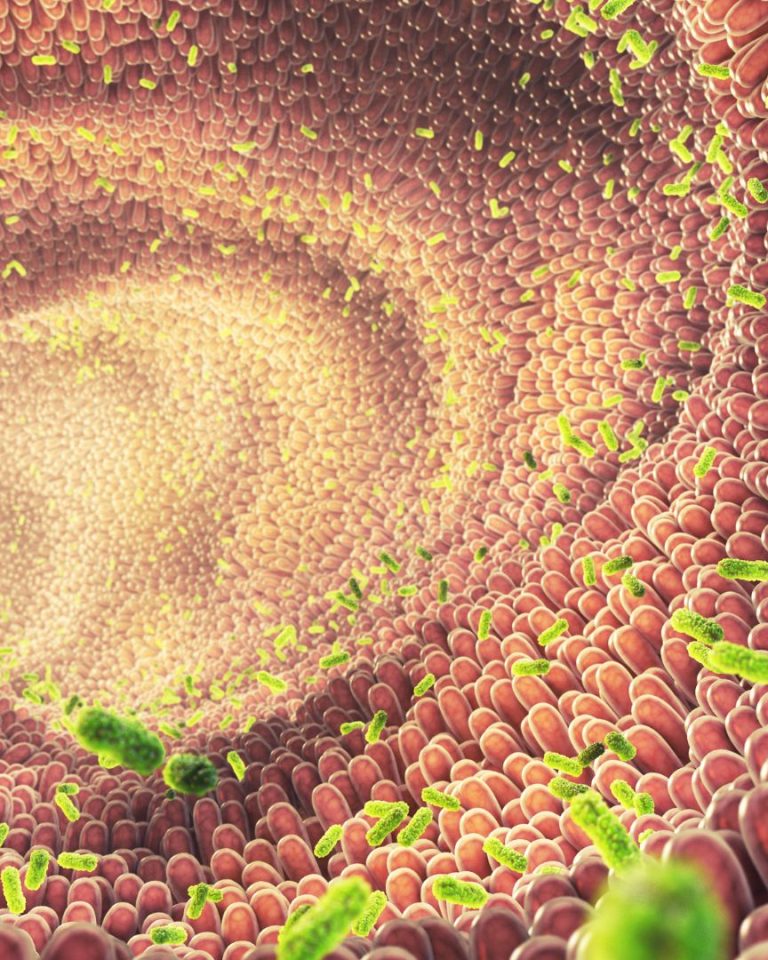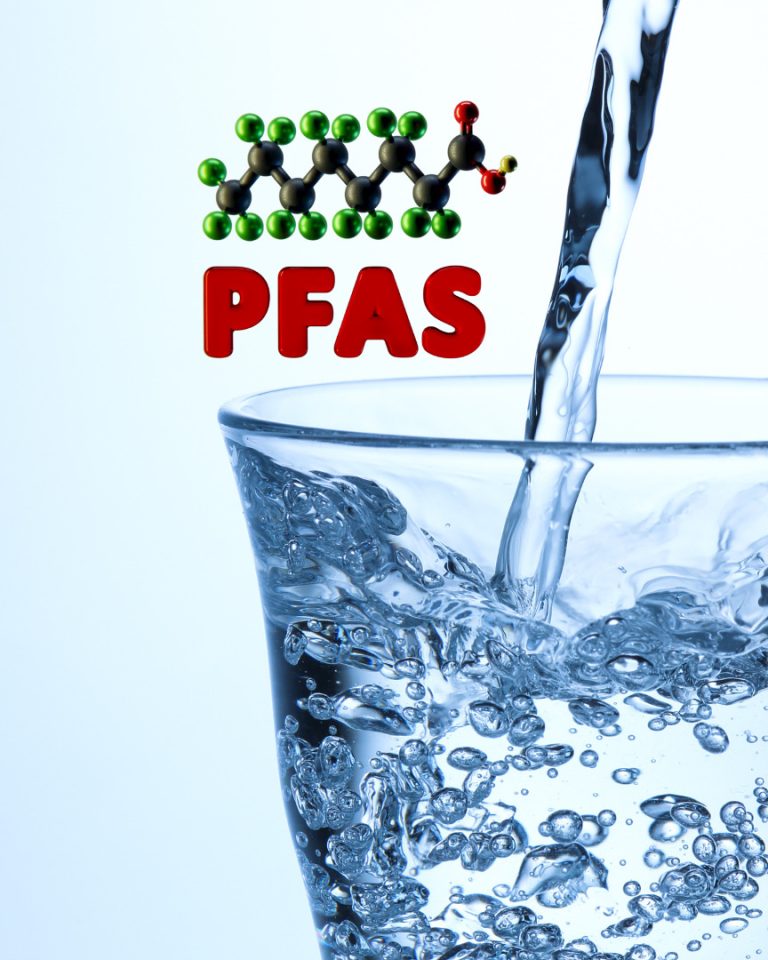Alors qu’une vague de chaleur intense et précoce s’annonce sur la France du 15 au 18 juin, Natura Sciences revient sur les nouvelles prévisions climatiques pour la France à l’horizon 2100. Entretien avec Mary Kerdoncuff, directrice adjointe chargée des opérations à la Direction de la climatologie et des services climatiques de Météo-France.

Météo-France prévoit une vague de chaleur intense en France à partir de mercredi jusqu’au week-end. Elle commencera par concerner le sud du pays. Son extension plus au nord est encore incertaine. « Les maximales devraient atteindre ou dépasser en milieu de semaine les 35 à 38°C et les minimales ne descendront pas en dessous des 20°C […] Les seuils de canicule pourraient être atteints voire dépassés », prévient l’organisme dans un communiqué qui souligne des incertitudes sur sa gravité. « Cette hausse des températures est due à une dépression localisée entre les Açores et Madère favorisant les remontées d’air chaud sur l’Europe occidentale », précise le communiqué. L’organisme s’inquiète de la « précocité remarquable de cet épisode qui est un facteur aggravant ».
Les vagues de chaleur sont appelées à se multiplier progressivement avec le changement climatique. Mais jusqu’où pourrait aller la hausse des températures et la multiplication de ces épisodes ? Alors que Météo-France prévoit jusqu’à +6°C l’été en 2100, l’évolution à venir des précipitations pose aussi question. On fait le point avec Mary Kerdoncuff, directrice adjointe chargée des opérations à la Direction de la climatologie et des services climatiques de Météo-France.
Natura Sciences : Les nouvelles prévisions de Météo-France prévoient une hausse des températures jusqu’à 6°C en été en 2100 par rapport à la période 1976-2005. Comment interpréter ces prévisions alarmantes?
Mary Kerdoncuff : Les prévisions sont certes un peu alarmantes mais réalistes. Compte-tenu de l’inertie climatique du système Terre, l’avenir du climat est déjà tracé jusqu’en 2040. La température va continuer d’augmenter et il y aura plus de canicules. Même si l’on stabilisait les émissions dès aujourd’hui, le climat deviendra beaucoup chaud. Nous connaîtrons des conditions climatiques plus sévères dans les prochaines années. D’ici 2050, les projections estiment qu’il y aura 5 à 15 jours de vagues de chaleur en plus et beaucoup plus de nuits tropicales. L’inconfort et les risques sanitaires vont donc croître.
Lire aussi : France : jamais chaleur n’a été aussi forte au printemps
A partir de 2040, l’évolution du climat diverge selon les politiques climatiques qui se mettront en place dans les prochaines années. Le climat de 2050 se décide aujourd’hui. Le résultat en 2100 ne sera pas du tout le même que l’on déploie des politiques climatiques drastiques avec de très fortes réductions de gaz à effet de serre, ou que l’on ne fasse rien. Dans le pire des scénarios, correspondant à une hausse des émissions tendancielles, la hausse des températures pourrait aller jusqu’à près de + 6°C par rapport à l’ère préindustrielle.
Il fera donc beaucoup beaucoup plus chaud et la vague de chaleur deviendra monnaie courante. Jusqu’à menacer la vie humaine?
Le scénario médian, le plus proche de l’objectif de l’Accord de Paris prévoit un réchauffement de 2,2°C en 2100 par rapport à 1976-2005. Il y aurait alors entre 10 et 15 jours de vagues de chaleur en plus par an, contre 20 à 30 jours supplémentaires dans le pire des scénarios. Les canicules deviendraient aussi plus longues. Ce que l’on appelle aujourd’hui « canicule » serait monnaie courante à la fin du siècle, avec des températures couramment de l’ordre de 50°C ou plus.
Il faudra mener des études sur notre capacité humaine à résister à une telle température. La vie dans le climat de 2100 sera très différente de celle que l’on connait aujourd’hui si on continue sur la trajectoire d’émissions actuelle. Il y aura notamment des risques considérables sur la ressource en eau, une hausse des feux de forêts, et des tensions accrues sur les usages, notamment pour l’agriculture.
Lire aussi : Météo France va renforcer ses services d’adaptation au changement climatique
Les températures augmenteront, mais qu’en sera-t-il pour les précipitations?
Pour les températures, les évolutions sont nettes et incontestables. Concernant les précipitations, les messages sont plus compliqués et il y a des contrastes forts entre les saisons et selon la géographie.
Nous avons suivi l’évolution de deux indicateurs : le cumul annuel des précipitations et le nombre de précipitations extrêmes. Au global, on prévoit plutôt une augmentation des précipitations sur la France métropolitaine. En revanche, si on décline cette analyse par saisons, on observe que la pluviométrie augmente l’hiver, mais baisse l’été. Cela signifie que l’on aura des températures de plus en plus chaudes et de plus en plus de canicules l’été, mais aussi de moins en moins de précipitations. Cela augmentera les problèmes de sécheresses.
Il y a encore quelques années, nous avions tout de même des orages l’été qui permettaient aux sols de se recharger en eau pour l’agriculture. Mais ces dernières années, les sécheresses deviennent de plus en plus importantes, notamment dans le Centre et dans le nord-est de la France. Cette tendance va se renforcer.
Sur les précipitations, il y a en plus un gradient nord-sud, un peu inquiétant. La partie sud de la France s’assèche plus. Ce signal est identifié depuis un moment. Cela est compréhensible, puisque la France est une zone de transition en matière de climat, avec l’Europe du nord plus humide et l’Europe du sud, plus sèche.
Pourquoi utiliser plusieurs modèles et avoir retenu la période de référence 1976-2005?
Ces projections climatiques se basent sur un ensemble de modèles. Les modèles ont chacun des avantages et des inconvénients, car il est difficile de prendre en considération toutes les variables du système Terre. Lorsque l’on fait de la simulation climatique, il ne faut pas regarder un seul modèle, puisqu’il peut avoir un biais systématique. Par exemple, il peut trop réchauffer, ou pas assez, ou prévoir trop de précipitations. On a donc l’habitude de travailler sur un ensemble de modèles afin de calculer des incertitudes. Pour mener ces projections climatiques, nous avons utilisé 12 modèles différents.
En matière d’étude du climat, il faut des périodes de référence de 30 ans. Or, l’année la plus récente reconstituée par les modèles est 2005. Nous avons donc retenu la période 1976-2005 pour faire cet exercice. Aux températures calculées par le modèle, il faut donc rajouter 0,8°C dans un second temps. Cette température correspond à l’écart de température entre la période 1976-2005 et l’ère pré-industrielle. Ainsi, un réchauffement optimiste de 1,3°C à l’horizon 2100 par rapport à 1976-2005 donne en réalité une hausse des températures de 2,1°C par rapport à l’ère préindustrielle. Un réchauffement médian de 2,2°C donne ainsi un réchauffement de 3°C et un réchauffement pessimiste de 3,9°C équivaut à 4,7°C. Finalement, une hausse de +6°C l’été en 2100 reviendrait à une hausse des températures de +6,8°C par rapport à l’ère préindustrielle.