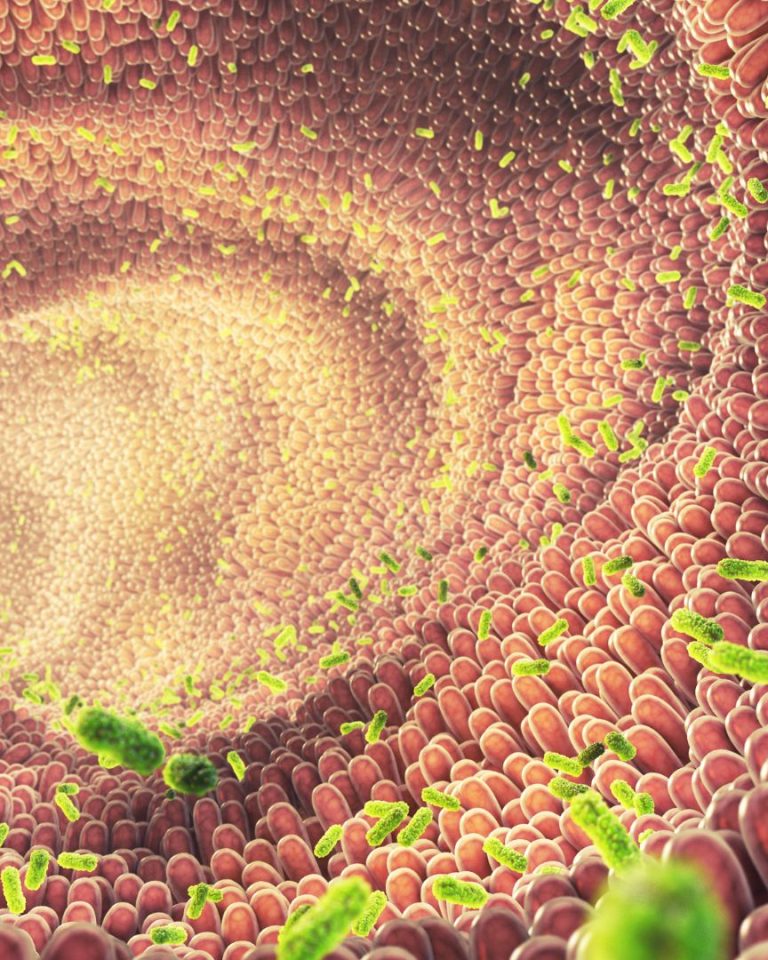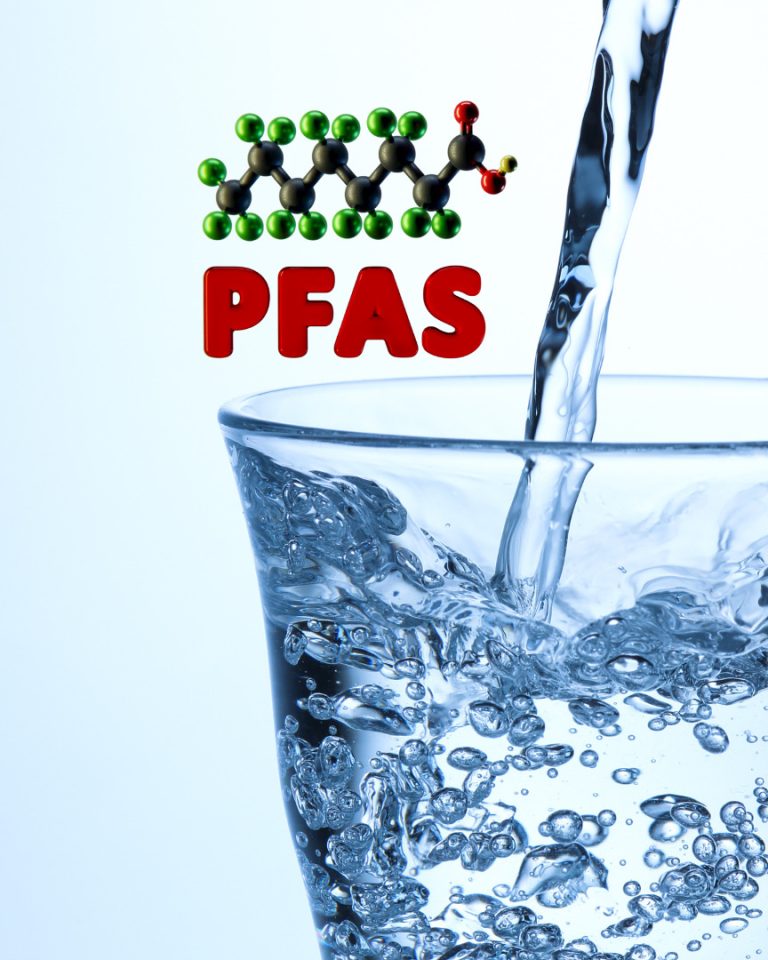Cela fait déjà deux ans. Le 15 avril 2019, la toiture et la flèche de la cathédrale Notre-Dame brûlaient, avec leurs 460 tonnes de plomb. Une partie fond, une autre s’envole sous forme de poussières et se dépose sur le parvis et les rues avoisinantes. Si les plombémies réalisées quelques mois plus tard se veulent rassurantes, le retard à l’allumage pose question. Et l’association Robin des Bois dépose une plainte avec constitution de partie civile pour « mise en danger de la vie d’autrui ».

Lorsque la flèche de Notre-Dame tombe, la stupeur l’emporte. Durant les premières semaines, les autorités minimisent les risques liés à l’émission de plomb. Santé publique France ne recense que trois plombémies infantiles réalisées en avril, 29 en mai et 76 en juin. Le dépistage augmente progressivement. Il atteint 403 plombémies en septembre sur des enfants dans cinq arrondissements parisiens (1er, 4e, 5e, 6e et 7e). Le scandale sanitaire redouté semble évité. Le dernier bilan publié par l’Agence régionale de santé (ARS), un an après le sinistre, recense la réalisation de 1.216 dosages du taux de plomb dans le sang. 8,2% se trouvent entre le seuil de vigilance (25 microgrammes par litre) et le seuil de déclaration obligatoire (50 µg/L). Seulement 1,1% des plombémies dépassent ce seuil.
Pour ces 1,1%, « une source d’exposition au plomb dans l’environnement habituel a été décelée dans presque tous les cas (balcons notamment) », ajoute l’agence. Elle souligne aussi que cette proportion est « un peu inférieure » à celle qu’on retrouve en moyenne dans la population des 0-6 ans. À faible dose, le plomb peut provoquer des troubles digestifs, une perturbation des reins, des lésions du système nerveux ou des anomalies de la reproduction. Les jeunes enfants sont les plus vulnérables à cette intoxication, aussi appelée « saturnisme« , car leur système nerveux reste en plein développement. En plus, ils portent plus aisément des objets contaminés à la bouche.
Le plomb, une « bombe à retardement » à Notre-Dame
Mais pour Mathé Toullier, présidente de l’association des familles victimes du saturnisme (AFVS), « les plombémies faites quelques mois après ne valent rien ». Le métal « reste maximum huit semaines dans le sang après une intoxication« , explique-t-elle à l’AFP. Ensuite, il se stocke dans le cerveau, le foie, les reins et les os. Or, la majorité des tests se sont déroulés au moment de la rentrée de septembre 2019. Les enfants avaient alors souvent passé des vacances dans un autre environnement non contaminé.
« Le plomb c’est une bombe à retardement » qui peut produire des effets à l’âge adulte s’il est « déstocké », prévient-elle. Il aurait fallu « un protocole systématique » pour tester « les dizaines de milliers d’enfants » concernés, juge Jacky Bonnemains, président de l’association Robin des Bois.
Lire aussi : Feux en Australie : autant de fumées que l’éruption du Pinatubo en 1991
L’organisation de défense de l’environnement s’inquiète aussi du devenir des gravats du chantier. Certains d’entre eux ont été « conservés à des fins de recherche et d’étude patrimoniale« . Mais ils ne se trouvent pas dans des sites agréés pour le traitement des déchets pollués.
L’association des familles victimes du saturnisme (AFVS), Robin des Bois et le Conseil de la ville de Paris reprochent enfin la décision de reconstruire à l’identique et avec les mêmes matériaux. « On reprend les matériaux dont l’association a été catastrophique dans l’incendie, la charpente en bois ayant propagé le feu aux feuilles de plomb » qui fondent à faible température, s’indigne Jacky Bonnemains. Même en temps normal, le plomb disperse facilement des poussières sous l’effet de l’érosion, fait-il valoir.
Robin des Bois enfonce le clou et porte plainte
Robin des Bois a déposé jeudi 8 avril une plainte avec constitution partie civile. L’association dénonce « mise en danger de la vie d’autrui ». Selon elle, « enclencher une enquête sur les conséquences sanitaires et environnementales de l’incendie », et en particulier celles liées aux poussières de plomb émises lors du sinistre, relève de l’« obligation », a expliqué à l’AFP son président, Jacky Bonnemains. Pour lui, les dépistages des enfants du quartier ont été trop peu nombreux et trop tardifs. En plus, la question de la gestion du plomb sur le chantier « n’est pas du tout réglée ». Et la réouverture du parvis de la cathédrale, le 31 mai 2020, après un nettoyage à haute pression, était « prématurée ».
L’association avait déjà déposé une plainte simple pour le même motif en août 2019, quatre mois après l’incendie. Mais elle avait été classée sans suite en décembre 2020, selon un courrier du parquet consulté par l’AFP. Dans ce courrier, le procureur de la République fait notamment valoir que l’intoxication au plomb « intervenant essentiellement par voie d’ingestion », la seule présence de ce métal lourd dans l’environnement « ne signifiait pas que les travailleurs et les riverains (…) couraient un danger tangible de saturnisme ». Il ajoute que les préconisations de l’Agence régionale de santé Ile-de-France « centrées sur un désempoussiérage/dépollution » dans les zones fréquentées par de « très jeunes enfants paraissaient adaptées à la situation ».
La nouvelle plainte permettra d’obtenir quasi-automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire et la désignation d’un juge d’instruction. « De nouveaux arguments, postérieurs au dépôt de notre plainte » d’août 2019, « nous font dire que les problèmes sanitaires sont toujours d’actualité », assure Jacky Bonnemains.
Matthieu Combe avec AFP