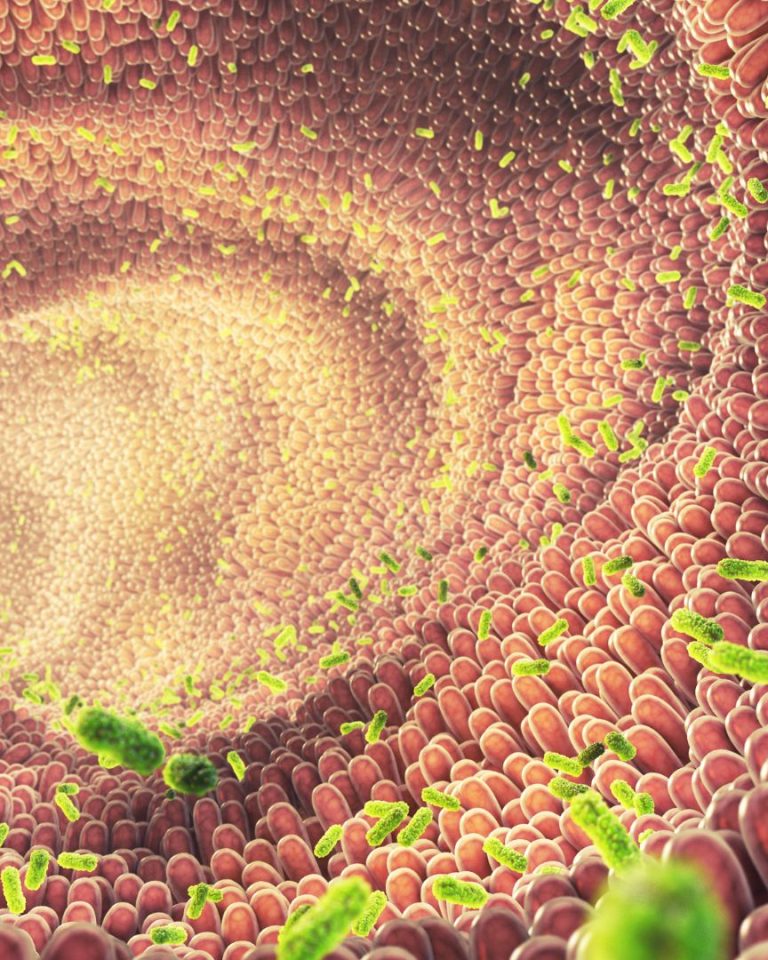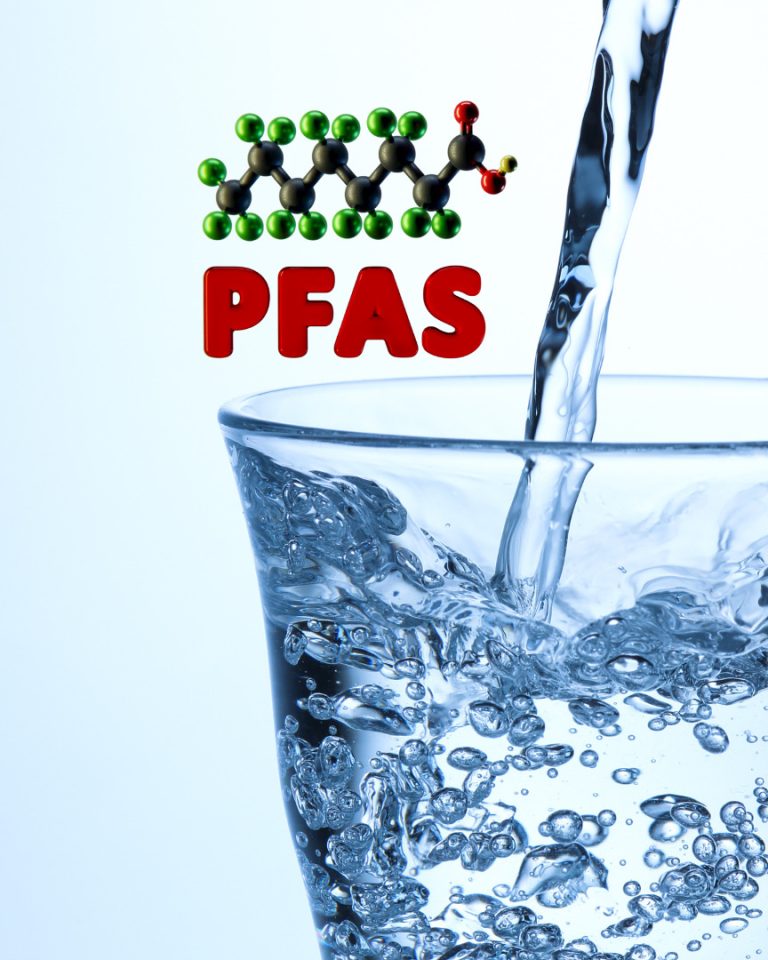Une trentaine d’économistes, parlementaires, syndicalistes et représentants de la société civile ont lancé un appel à réformer les règles budgétaires européennes. Ils souhaitent remplacer le “pacte de stabilité et de croissance” par un « pacte de résilience et de solidarité » plus adapté aux défis écologiques.

Peu connu du grand public, le pacte de stabilité et de croissance (PSC) impacte pourtant notre quotidien. C’est lui qui coordonne et conditionne les politiques budgétaires nationales de chacun des pays membres de l’Union. En pratique, les États membres fixent chacun leur budget en fonction des contraintes imposées par ce pacte. C’est notamment lui qui dicte aux pays la règle selon laquelle le déficit public ne doit pas dépasser les 3% de son P.I.B, sous peine de sanctions.
Vendredi dernier, plusieurs dizaines d’économistes, personnalités et organisations françaises ont lancé un appel à le réformer. « Alors que la France prendra la présidence de l’Europe au 1er janvier, et dans un contexte de campagne présidentielle, on a voulu faire monter ce sujet complexe mais fondamental. Ce pacte a structuré les politiques budgétaires de la France au cours des deux derniers quinquennats« , insiste Kevin Puisieux, coordinateur du think tank de la Fondation Nicolas Hulot. Les signataires plaident en faveur d’une transformation profonde des règles budgétaires européennes. Ils souhaitent remplacer ce PSC par un « pacte de résilience et de solidarité« .
Un système qui bloque la transition écologique des pays
Pour les signataires, le pacte tel qu’il existe entrave la transition. Dans cet appel, on peut lire que, « les règles d’aujourd’hui, basées sur les seuls objectifs d’équilibre budgétaire, sont incompatibles avec les défis actuels (… ) et ne tiennent pas compte des risques de l’inaction écologique et sociale« . Kévin Puisieux, souligne qu’il « paraît essentiel, dans une période où la commission européenne affirme une ambition autour du pacte vert, de poser la question de la cohérence et des moyens mis au financement d’une transition écologique qui soit socialement juste« . L’un des objectifs du « pacte de résilience et de solidarité » serait donc de prendre en compte les risques écologiques et sociaux dans le pilotage budgétaire de l’Union.
Les finances publiques au service d’une transition juste
Dans ce nouveau « pacte de résilience et de solidarité » proposé, l’idée est d’encourager les dépenses publiques nécessaires à une transition écologique. Ces dépenses seraient alors exclues du calcul du déficit et encouragées. Elles ne rentreraient donc plus dans la limite des 3% aujourd’hui fixés. Pour les signataires, ce modèle de financement ne devrait pas se limiter aux investissements verts des entreprises. Il doit également aider ceux des ménages.
Ce nouveau pacte bénéficierait également à la formation professionnelle et à l’accompagnement des travailleurs de secteurs en transition. « Si ces règles n’évoluent pas, au moins pour des questions démocratiques, qu’elles évoluent pour des questions climatiques. Notamment en ouvrant la possibilité de mobiliser de l’investissement public vert. Mais aujourd’hui, du fait des règles du pacte, cela est sévèrement contraint » explique Shahin Vallée, économiste au DGAP (German Council for Foreign Affairs), ancien conseiller d’Emmanuel Macron. Shahin Vallée a bon espoir car d’après lui, « il semble qu’une fenêtre de discussion s’ouvre sur l’investissement vert« .
Définir un investissement vert pour l’exclure du calcul du déficit public
Si on envisage de ne plus comptabiliser les dépenses de transition écologique dans le déficit public, comment peut-on définir un investissement vert? « C’est la question centrale » selon l’économiste au DGAP. Il explique qu’aujourd’hui, il existe ce qu’on appelle la taxonomie. Il précise que celle-ci « fait partie d’un corpus de réglementation financière, qui va pousser les entreprises du secteur financier à classer plusieurs activités selon qu’elles aident à lutter contre le changement climatique ou non« . Dans ce cadre, on a notamment pu voir émerger des débats pour savoir si le gaz naturel était ou non un investissement vert. De même pour le nucléaire.
Shahin Vallée concède que « ce sera un sujet très difficile, mais on a fait d’énormes progrès« . D’après lui, « ce travail est encore embryonnaire et fragile. Il va nous occuper des mois, si ce n’est des années. Mais on commence tout de même à s’entendre sur une méthodologie, et sur la définition de ce que sont les investissements verts« .
Impossibilité de chiffrer le projet
Dans cette logique, à combien vont s’élever les dépenses publiques en faveur de la transition écologique ? « Dans notre appel, nous n’avons pas souhaité mettre de chiffres. L’une des raisons est qu’il sont fragiles« , explique Kévin Puisieux. Pour lui « le risque serait de se dire qu’on a besoin de tant d’argent, et de s’arrêter sur un calcul qui malheureusement ne serait pas forcément compatible avec la réalité des besoins qu’on va en partie découvrir au fil du temps« .
« Nous on souhaiterait, et c’est le sens de notre tribune, qu’il y ait un débat ouvert et démocratique qui mène à une véritable réforme des règles« . Une réforme au niveau européen peut prendre de nombreuses années. Face au dérèglement climatique qui accélère, une autre solution est envisagée par Shahin Vallée. Pour lui, « réformer, ça peut tout et rien dire. Si on souhaite faire une réforme en profondeur, il faudra effectivement passer par plusieurs véhicules législatifs, ce qui peut prendre une dizaine d’années. Mais réformer peut aussi passer par une réinterprétation des règles. Un pouvoir qu’à aujourd’hui la commission« . L’économiste au DGAP met en garde. Il souligne qu’il « faut faire attention aux obstacles qu’on s’invente. Il y a des difficultés réelles. Mais quand il y a une volonté politique, on arrive à les surmonter« .
Ouns Hamdi